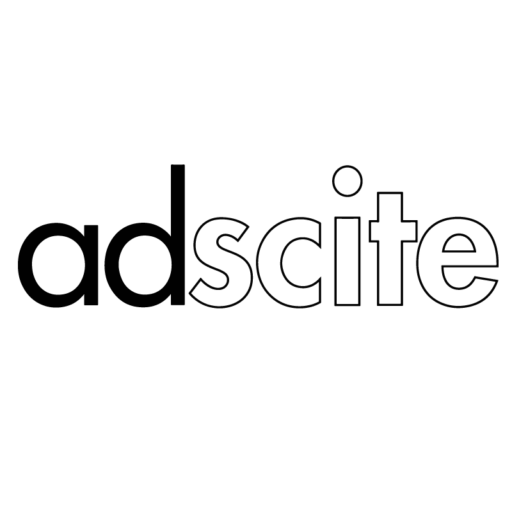Bertrand Burgalat, les initiales BB de 2017


Cinq ans après son dernier album, Bertrand Burgalat (découvrez l’autoportrait de Bertrand Burgalat) revient avec Les choses qu’on ne peut dire à personne, un merveilleux enchaînement de ballades mélodieuses. Une demie décennie qui a laissé le temps à l’artiste de réaliser un album live, quatre bandes originales de films, d’écrire un essai aux Éditions lmann-Levy, ou encore d’animer un émission musicale sur France Inter et une autre sur Paris Première. Tout en continuant de produire sur son label Tricatel les artistes Chassol (découvrez l’autoportrait de Chassol), Catastrophe (découvrez l’autoportrait de Catastrophe), Vanessa Seward, etc. Et ça, c’est sans préciser ses arrangements, ses compositions et autres projets.
Bertrand Burgalat est prolifique. Hourra la musique française à encore de beaux jours devant elle…
Commençons par ton dernier album, Les choses qu’on ne peut dire à personne, que peux tu nous raconter ?
J’ai abordé cet album par de multiples méthodes. Certains morceaux étaient fournis de base, avec voix et mélodies déjà existantes, n’attendant plus qu’un texte. D’autres étaient plus bruts, moins complets, j’avais seulement les harmonies en tête. Chaque morceau s’est créé différemment, cela m’a permis de créer dix-neuf titres qui ne se ressemblent pas, tout en gardant une certaine unité.
L’enregistrement, quant à lui, s’est fait de manière fluide pour que l’on ressente l’énergie dans la musique. Je n’avais pas envie qu’il se passe trop de temps entre le début de l’enregistrement et la sortie du disque. Mon album The Sssound of Mmmusic m’avait traumatisé. Il était presque terminé en 1996, pour finalement sortir en 2000. Ça me rendait fou. Aujourd’hui, même si parfois j’ai certains morceaux en tête depuis un moment, quand je rentre en studio c’est pour aller vite. Pour Les choses qu’on ne peut dire à personne, j’ai commencé l’enregistrement en novembre 2016 pour sortir l’album en mai 2017. Le boulot s’est fait bien plus vite, sans pour autant passer trente jours continus enfermé dans un studio. J’y passais deux-trois jours, par-ci par-là, ce qui est aussi une contrainte imposée lorsque le budget n’est pas illimité.
Peux-tu nous parler des différents textes de Les choses qu’on ne peut dire à personne ? Comment as-tu fait ta sélection d’auteurs ?
Déjà, pour moi, le critère pour choisir un texte n’est pas : « est-ce que ça me ressemble ? » car je ne me considère pas comme un personnage ou une marque. C’est plus : « est-ce que ça correspond à ce que je ressens le besoin d’exprimer ? » Donc certains textes formidables ne collent pas forcement au reste d’un projet. Surtout qu’à mon sens, les textes ne doivent pas trop se ressembler, ils doivent se compléter, comme les parties d’un film où des éléments de dialogue se répondent pour faire avancer le propos. Les choses qu’on ne peut dire à personne est parsemé de textes d’auteurs très différents et j’ai remarqué, essentiellement grâce aux retours du public, que les morceaux qui paraissent les plus personnels sont ceux dont je n’ai pas écrit les paroles. D’ailleurs pour certains textes, ils n’ont même pas été écrits en pensant à moi. Une chanson comme Les choses qu’on ne peut dire à personne, pensée et créée par Laurent Chalumeau, ne m’était pas destinée. Laurent avait imaginée la chanson un peu dans le vide, sans que nous ne nous connaissions.
Tu évolues dans ton propre label, Tricatel, cela change-t-il quelque chose dans ta manière de travailler ?
Le fait que je sois sur mon propre label m’apporte plus de tracas que de confort. Quand on signe chez une major on reçoit souvent une avance financière et un encadrement complet. Alors que lorsqu’on bosse chez soi, pour soi, il faut se financer et se cadrer seul. Heureusement, je suis accompagné par une équipe réduite de personnes talentueuses en qui j’ai totalement confiance.
Sortir mes disques sur mon label explique aussi la raison pour laquelle je mets du temps entre chaque album. En général, je ne me presse pas. Je préfère travailler sur d’autres projets, comme sortir de beaux disques chez Tricatel, et attendre le moment où je me dis : « rentre en studio pour toi maintenant, ou tu le regretteras plus tard. »


Après, être chez soi a des avantages, jamais Tricatel ne m’enverra un courrier du type : « Cher Bertrand, n’oubliez pas que nous sommes en contrat et qu’il faudrait peut-être nous faire un nouvel album. » Chez nous, on essaye simplement de sortir peu de disques pour avoir les moyens de nous en occuper pleinement.
Ça rejoint ce que nous disait Christophe Chassol. Il ajoutait même que Tricatel était comme une petite famille…
J’aurais adoré faire de Tricatel une version free jazz de AB Productions – AB Disques. Bâtir une espèce d’usine à tube indé, créant des artistes de toute pièce, avec des identités marquées et uniques, mais j’en suis incapable. Du coup, ce que nous avons fait de Tricatel est diamétralement opposé. Chez nous, les artistes ne bénéficient pas forcément du confort matériel qu’ils auraient peut-être ailleurs, mais nous les aimons réellement et sommes à fond derrière eux pour les soutenir. Sans jamais interférer avec leurs souhaits, les artistes auront toujours le dernier mot. Par exemple, si demain Christophe Chassol me dit : « je veux faire un disque de métal satanique ou alors de techno estivale », même si ce n’est pas trop mon truc, je lui poserais des questions pour comprendre sa démarche. Et si c’est réellement ce qu’il souhaite faire, nous le ferons. Je considère que si un mec aussi talentueux que lui doit passer par là, ce n’est pas pour rien, alors je le suivrais. Bon, après ça m’étonnerait que Christophe passe par là.
Pour le fonctionnement de Tricatel, je suis conscient de mon époque, où la musique passe par internet. En 2011, nous avions produit une EP intitulé Keep Cool pour La Classe, une bande de jeunes très doués. Pourtant, nous n’avons pas poursuivi avec eux. Ces jeunes gens, à la vingtaine, savaient ce qu’ils voulaient, peut-être trop bien, tandis que nous, Tricatel, ne trouvions rien à leur apporter. Nous n’aspirions pas à être uniquement une boîte aux lettres pour eux. Il nous fallait du dialogue et eux connaissaient trop bien leur ligne. Aujourd’hui, il est tellement simple de sortir son album tout seul, l’autoproduction n’est pas une chimère. Il suffit de regarder un groupe comme PNL pour le comprendre.
Parmi les jeunes gens talentueux chez Tricatel, il y a Catastrophe maintenant. Comment va le groupe ? Comment a-t-il atterri chez toi ?
Catastrophe termine son premier album qui devrait sortir cet automne, un peu plus d’un an après l’EP. Pour la rencontre, ça remonte à la sortie de mon précédent disque Toutes Directions. J’étais tombé sur un clip posté sur Brain. J’y découvrais une fille, très belle, qui dansait sur Bardot’s Dance partout, dans la rue, dans le train, au supermarché, etc. Je soupçonne d’ailleurs les réalisateurs du clip Happy de Pharrell Williams, (We Are From L.A., ndlr) de s’en être bien inspiré. Sauf que là, c’était plein de grâce. Bref, la vidéo m’intriguait. Puis un jour, me voilà invité à la radio avec Benoît Forgeard que je ne connaissais pas encore et sur place je tombe sur l’équipe de Catastrophe. Tous formidables, singuliers, sans aprioris dans leurs jugements. J’ai adoré cette rencontre. Ils sont hyperactifs, ils touchent à tout. Depuis que je les connais, nous bossons sur plein de projets très intéressants. Je ne peux pas être leur grand-père, mais nous n’en sommes pas loin avec nos trente ans d’écart. Notre relation est amusante, je n’incarne pas un rôle paternaliste de grand ancien, mais je leur apprends des choses, autant que eux m’en apprennent.
C’est marrant comme une rencontre, comme une simple interview à la radio peut déclencher plein de trucs. Je ne vais pas dire que cela a changé ma vie, mais presque. Rencontrer Benoît Forgeard, et Pierre Jouan, Arthur Navellou, Blandine Rinkel de Catastrophe fut très stimulant. Depuis, nous essayons de faire un maximum de choses ensemble, quand ils arrivent à trouver du temps entre leurs nombreux autres projets. Par exemple, à la rentrée ils sortent un livre sous le nom Catastrophe, Blandine a déjà écrit son premier roman L’Abandon des prétentions. Ils évoluent tous dans les arts, la musique et le cinéma, c’est passionnant et je suis heureux de les voir continuer à grandir et concrétiser leurs vœux.
« Les » Catastrophe qui évoluent dans le cinéma ce n’est pas nouveau pour Tricatel. Tu connais bien le milieu, pour avoir signé de multiples bandes originales. Comment appréhendes-tu cette partie de ta carrière ?
Les films sur lesquels je travaille ont souvent à leur tête un réalisateur obligé de se battre pour faire exister son projet. Les budgets sont souvent limités pour les tournages, donc très limités pour la musique. Pourtant, le manque de moyens financiers pour la partie musicale n’est pas gênant sur le plan créatif. Quand je fais une musique de film, je n’essaye jamais de faire mon disque à travers. J’estime que je suis au service de la vision du réalisateur, avec qui un dialogue s’installe afin que je saisisse l’intégralité du sujet et également toutes ses attentes et envies. En collaborant avec Bertrand Tavernier sur Quai d’Orsay, j’ai compris ce qu’était réellement un réalisateur. Bertrand arrive à la fois à être très précis, sans assommer de références plombant le sujet et, surtout, il n’est jamais intimidant. Il donne confiance, il donne envie aux gens de l’épater, c’est génial.
Au-delà de mes musiques de films, il y a Christophe. Quand je vois Chassol, je vois de grandes choses. Je pense que pour le moment Christophe n’a pas encore trouvé son Fellini. Un jour, une rencontre se produira avec un réalisateur de grand talent et ce sera le tremplin mérité. Chassol n’est pas encore utilisé à sa pleine puissance par les réalisateurs. Dans un sens tant mieux, ça lui laisse le temps d’aller encore plus loin. D’ailleurs, je suis certain que si il a autant travaillé avec l’image, c’est qu’à l’époque il ne se sentait pas assez sollicité par le cinéma. Bref, une chose est certaine, Chassol a la capacité de faire de très grandes musiques de film, des choses inoubliables. Il ne lui manque que son cador d’Hollywood.
D’ailleurs, entre Chassol et moi, le cinéma est là depuis le début. Il m’a remplacé pour le thème musical Gaumont, un truc qu’ils ne changent que tous les dix ans. Il m’a écrit et nous nous sommes rencontrés. J’ai très vite vu son talent. Pour moi, il n’y a que deux catégories de musiciens, ceux avec lesquels nous sommes en compétition et ceux avec lesquels nous sommes fraternels. Avec Christophe se fut la seconde catégorie.
Quelles sont tes influences musicales ?
En cinquante-trois ans des strates se sont accumulées. Quand j’avais dix ans, j’adorais Pink Floyd, le rock progressif, puis très vite Kraftwerk. Les courants se sont enchainés, du jazz, du jazz rock, puis de la New Wave. Dans les années 1980, je me suis attardé sur la chanson française en écoutant Polnareff et Gainsbourg. Puis de la soul, du pré reagge, avant de revenir au jazz, non démonstratif cette fois, de Ellington à Archie Shepp. En musique classique, j’adore tout le début du XXème siècle, de Claude Debussy à Maurice Ravel.
Toutes ces influences se convoquent elles mêmes dans mon travail. Surtout que j’improvise beaucoup en studio. Par exemple, un morceau comme Tombeau pour David Bowie, un titre hiératique et très sacré, fait penser à la période Low de Bowie où ses instrumentaux, faits avec Brian Eno, sont extraordinaires. Pourtant, ce qui m’a influencé pour ce morceau c’est Le Banquet Céleste de Olivier Messiaen. Autre exemple, on retrouve plus ou moins You Are The Sunshine Of My Life de Stevie Wonder dans l’arpège sur l’intro de Ultradevotion, mais c‘était inconscient. Maintenant, quand j’étends Ultradevotion ça me rappelle Wonder pour un unique arpège. On retrouve aussi ce genre de descentes et montées chez Thelonious Monk.
J’ai la chance d’être vieux, c’est déprimant d’avoir vingt ans de nos jours et d’entendre sans cesse que tout a déjà été fait. Avec cette idée, seule la consommation est importante. Maintenant l’artiste est presque moins important que le programmateur de festivals, de concerts ou de films, moins important que le curateur qui va placer, ou non, tel artiste. Je trouve ça mortifère, alors qu’il est encore possible d’inventer. Même en s’aidant des nouvelles technologies, sans pour autant tomber dans un futurisme béat.
Ce sentiment du « tout a été fait » empêche certains artistes de reconnaître leurs influences, ils s’en cachent et produisent souvent des choses moins qualitatives. C’est stupide, certes beaucoup de choses ont été inventées, mais ça ne s’oppose pas à la création. Au contraire, parmi les plus grands artistes beaucoup étaient admirateurs, voire fanatiques, d’autres artistes. C’est la passion qui stimule la créativité.
On retrouve ce problème dans les films où, de nos jours, 80% des musiques utilisées sont préexistantes. C’est triste et moche. Si nous avions toujours agi ainsi, le monde du cinéma et des arts serait nul. Comment auraient-ils fait pour Ben-Hur ? Ils auraient sélectionné des musiques antiques ? Bonne chance pour trouver.
Pour les péplums, de nos jours, il suffit de mettre une femme faisant des vocalises accompagnée de cuivres pour contenter tout le monde. N’est-ce pas un autre problème, le manque d’ambition, de pertinence, de style ?
De nos jours les péplums n’accordent plus grande attention à la musique, mais un type comme Miklós Rózsa pour Ben-Hur avait inventé une antiquité fantasmée passionnante. Pour la pertinence, prenons les années 1960 comme exemple. Il n’y avait quasiment pas de rock au cinéma. Les thèmes et musiques étaient faits par des mecs plus vieux. Même Blow-Up, le film de Michelangelo Antonioni, « Swinging London » par excellence, comporte une unique scène de concert rock avec The Yardbirds, sinon c’est Herbie Hancock qui s’y colle.
Cependant, pour l’utilisation de musiques préexistantes, heureusement, il existe des contre-exemples qualitatifs, comme avec Stanley Kubrick qui était un maniaque du contrôle. Tellement dingue, qu’il n’aimait pas être conduit par autrui. En taxi, il obligeait les mecs à rouler à vingt kilomètres par heure en prétextant un mal de dos. Mais tout le monde n’a pas le talent d’un Kubrick. Pour moi, un film est une œuvre originale intégrale, qui doit avoir un scénario et des dialogues originaux, des costumes et décors originaux, et donc une musique originale.
Quittons un peu le cinéma pour la littérature. Tu as fait un album avec Michel Houellebecq, cet exercice pourrait-il revoir le jour, avec lui ou un autre auteur ?
Avec Michel, c’était un coup de foudre, une admiration très forte dès 1995. Le projet avec lui, Présence humaine, était riche et compliqué à mettre en place. Juste après, nous avions tenté de renouveler l’expérience avec Philippe Muray, malheureusement ça ne s’est pas fait. Avec Michel Houellebecq, il y a eu des moments compliqués, mais je ne garde que des bons souvenirs et une certaine tendresse vis-à-vis de lui. Maintenant, quand j’aime un écrivain, je lui demande juste des paroles. Comme Virginie Despentes avec qui nous avons travaillé pour A.S. Dragon. En y pensant, ce boulot avec des auteurs, nous n’en sommes pas loin avec Catastrophe.
Un peu comme pour la musique, peux-tu nous donner tes influences culturelles ?
Je lis beaucoup mais assez peu de livres m’ont marqué. Je suis incapable de citer un bouquin qui aurait changé ma vie comme je peux le faire avec certains disques ou films. Par ordre d’importance, la musique sera toujours première chez moi. Le cinéma arrive juste après. D’ailleurs, j’ai eu la chance, vers la moitié des années 2000, de faire une carte blanche pour Ciné Cinéma. C’était merveilleux de pouvoir programmer les films qui avaient eu un réel impact sur moi. Nous avions même retrouvé un film tchèque de 1968 que j’avais vu à la télé à l’âge de cinq ans.
Encore une fois, tu reviens au cinéma. Ne serais-tu pas tenté de faire ton propre film ?
Je fais de la musique, j’ai derrière moi un essai sur le diabète, mais le cinéma non. Enfin si, mais comme toujours, pour les bandes originales. Pour moi, un véritable cinéaste, c’est quelqu’un de terriblement talentueux, et je n’ai pas le talent pour. Après, on peut faire de très bons films sans être un génie cinéaste, il faut savoir s’entourer d’une excellente équipe et avoir un propos viscéral à mettre en image. Je ne pense pas avoir la substance nécessaire pour ça. D’ailleurs, je me sens incapable d’écrire un roman, je n’ai rien à raconter, je ne veux pas narrer d’histoire.
À cause des durées de confection et d’appréciation de ces deux médias, film et roman ?
Non, ça vient de mes goûts. J’aime le réalisme fantastique. Pour moi, les choses les plus poétiques sont dans la vie courante. Je n’éprouve pas le sentiment d’avoir besoin de raconter des histoires. Cette non prédisposition à apprécier cela se retrouve dans mes lectures, je lis peu de romans et beaucoup d’essais. Et le peu de romans m’ayant marqués sont des œuvres fantastiques de J. G. Ballard ou de Philip K. Dick.
En y pensant, si aujourd’hui je ne faisais pas de la musique, je ne suis pas sûr que je m’appliquerais à faire une autre forme d’expression artistique.
Pourtant tu as écrit un livre sur le diabète.
Oui, mais je ne me suis jamais dit « vas-y Bertrand, écris donc un livre sur le diabète. » Cet essai existe à cause d’un sentiment de ras-le-bol, je n’en pouvais plus d’entendre des conneries sur le diabète. Là, pour le coup, c’était viscéral comme sentiment. Ça me rend dingue de voir les absurdités que les médias peuvent étaler sur cette maladie. C’est consternant, ils mélangent tout volontairement, pour attraper du gogo quinquagénaire un peu hypocondriaque, sans expliquer qu’il y a deux maladies qui n’ont rien à voir. Tous les diabétiques ne sont pas comme moi, obligés de se piquer dix fois par jours et de tout contrôler depuis quarante ans. Ces médias escrocs ont de la chance que les diabétiques soient gentils et qu’il n’existe pas une sorte d’association radicale qui irait foutre du sang sur la gueule des rédacteurs en chef de quelques célèbres hebdos français. Pourtant, beaucoup le méritent.
Plus positivement, le diabète m’a aidé dans mes choix de vie. J’ai toujours été persuadé que je décéderais très tôt, alors comme une combustion, la maladie m’a poussé à faire des choses, à créer et à m’épanouir dans ce que je fais.
Remerciement : Tricatel
Alexandre Fisselier